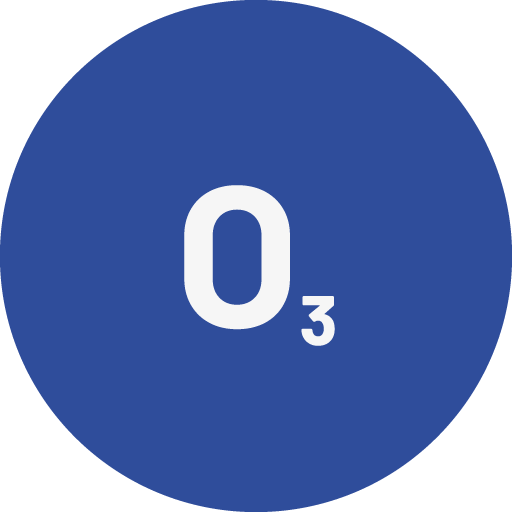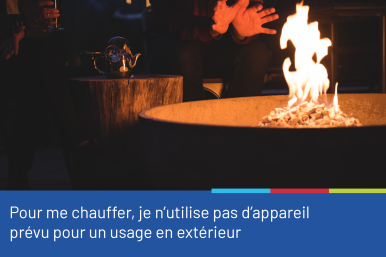Avec la baisse des températures, les chauffages principaux et d’appoint tournent à plein régime, augmentant les risques liés au monoxyde de carbone (CO). Ce gaz incolore, inodore et hautement toxique est responsable chaque année d’environ 3 000 intoxications en France, dont 1 000 nécessitant une hospitalisation et une centaine ayant une issue fatale (source). Pour se protéger de ce danger invisible, quelques précautions simples permettent de se chauffer en toute sécurité.
Un polluant intérieur de l’hiver
Le monoxyde de carbone est produit par une combustion incomplète de combustibles (bois, gaz, charbon, pétrole, propane...), souvent en raison d’un manque d’oxygène. Il peut provenir de nombreux appareils ou situations :
- Chauffages (cheminées, poêles, chaudières) et chauffe-eau
- Chauffages d’appoint ou groupes électrogènes utilisés dans des espaces fermés
- Appareils de cuisson ou braseros
- Moteurs automobiles fonctionnant dans des garages.
Les causes les plus fréquentes d’intoxication incluent des conduits obstrués ou mal dimensionnés, un manque de ventilation (pièces calfeutrées, bouches d’aération bouchées), un entretien insuffisant des appareils, ou encore une utilisation inappropriée (chauffage d’appoint en continu, groupes électrogènes en intérieur). Ces facteurs favorisent une accumulation rapide du gaz dans les logements.
Un danger présent dans divers lieux
Selon Santé Publique France, 86 % des intoxications au CO ont lieu à domicile, mais ce gaz peut aussi être émis dans des lieux publics mal ventilés, comme des salles de spectacle, restaurants, patinoires, ou lieux de culte. En milieu professionnel, les risques proviennent principalement d’outils à moteur thermique, de chariots élévateurs au gaz, de fours industriels ou de groupes électrogènes.
Les signes d’intoxication
Le monoxyde de carbone (CO) est un gaz incolore, inodore et non irritant : impossible à détecter sans matériel approprié. Hautement toxique, même en faible quantité, le monoxyde de carbone est un gaz qui se fixe sur l’hémoglobine à la place de l’oxygène, empêchant ainsi la bonne oxygénation des organes. De fait, ce gaz agit par asphyxie. Le cerveau et le cœur sont les organes les plus sensibles au manque d’oxygène.
L’affinité du CO pour l’hémoglobine est 210 à 260 fois plus forte que celle de l’oxygène. Même présent en quantité infime dans l’air, le CO se liera préférentiellement à l’hémoglobine du sang au lieu de l’oxygène.
Ses effets varient selon la concentration dans l’air :
- Symptômes légers : maux de tête, nausées, fatigue
- Symptômes modérés : vertiges, vomissements, somnolence
- Cas graves : évanouissement, coma, décès en moins d’une heure pour une exposition à 0,1 % de CO.
Chaque année, des milliers de personnes sont touchées, parfois gravement. En Bourgogne-Franche-Comté, par exemple, 185 cas ont été signalés entre le 1er juillet 2023 et le 30 juin 2024, dont 2 décès. (source : Agence Régionale de Santé de Bourgogne-Franche-Comté (ARS BFC)).
Prévenir et détecter le danger
La prévention repose sur des gestes simples :
- Faire entretenir chaque année ses appareils à combustion et conduits par un professionnel.
- Aérer quotidiennement, même en hiver.
- Utiliser les chauffages d’appoint ou groupes électrogènes uniquement dans des espaces bien ventilés et selon les consignes d’usage.
L’installation d’un détecteur de monoxyde de carbone peut également sauver des vies. Contrairement aux détecteurs de fumée obligatoires, les détecteurs de CO ne le sont pas. Il est crucial de choisir un appareil conforme aux normes NF EN 50291 ou NF292 pour garantir une fiabilité optimale. Placez-les à proximité des appareils à combustion (entre 1 et 3 mètres) ou dans les chambres, à hauteur de la tête.
Traitement et séquelles possibles
En cas d’intoxication, un traitement par oxygénothérapie (masque à oxygène ou caisson hyperbare) est requis. Les femmes enceintes nécessitent une attention particulière en raison des risques élevés pour le fœtus. Certaines victimes conservent des séquelles, comme des troubles neurologiques (mémoire, coordination) ou des migraines chroniques. Ces effets secondaires, appelés « syndrome séquellaire post-intervallaire », peuvent apparaître jusqu’à 40 jours après l’intoxication.
Les bons gestes
Quelques gestes simples peuvent permettre d’éviter un grand nombre d’accidents.
Toute l’année :
- J’aère mon logement pendant au moins 10 minutes chaque jour, même en hiver
- Je fais entretenir la Ventilation Mécanique Contrôlée et m’assure qu’elle fonctionne correctement
- Je ne bouche jamais les entrées d’air, même en cas de grand froid
- Je n’utilise pas en intérieur les appareils prévus pour l’extérieur (braséro, barbecue, grill, groupe électrogène)
- Je ne fais jamais fonctionner de moteur thermique dans un garage fermé (voiture, tondeuse, tronçonneuse…), même pour une courte durée
- J’installe un détecteur de monoxyde de carbone portant le marquage NF EN 50291 (ou NF 292), seule norme garantissant une mesure fiable
- Je nettoie régulièrement les brûleurs de ma cuisinière à gaz pour éviter tout encrassement qui pourrait perturber la combustion
Avant l’hiver :
- Je fais vérifier chaque année mes installations par un professionnel qualifié : chaudière, chauffe-eau, cheminées, inserts, poêles, conduits d’aération
- Je fais ramoner mécanique des conduits et cheminées au moins une fois par an, je m’assure qu’ils sont en bon état. L’évacuation des fumées doit impérativement se faire à l’extérieur de l’habitation
Pendant l’hiver :
- J’utilise mes chauffages mobiles d’appoint (fonctionnant au butane, propane ou pétrole) uniquement de manière ponctuelle, jamais plus de 2 heures, et toujours dans une pièce bien ventilée
- Je n’utilise jamais des appareils non prévus pour le chauffage : réchauds et radiateurs de camping, fours ouverts, pots de fleurs retournés sur les brûleurs de ma cuisinière, braséros, barbecues….
En cas d’intoxication ou si le détecteur CO se déclenche :
- J’aère immédiatement les locaux en ouvrant toutes les portes et fenêtres pour dissiper le gaz
- J’arrête si possible les appareils à combustion responsables
- Je fais évacuer tout le monde à l’extérieur, à l’air libre, en veillant à mettre les personnes en sécurité
- J’appelle les secours :
- Numéro d’urgence européen (112, ou 114 pour les personnes malentendantes)
- Les pompiers (18) ou le SAMU (15)
- Je suis leurs directives, comme la réanimation des victimes ou leur placement en position latérale de sécurité (PLS) si nécessaire
- Je ne réintègre les lieux qu’après l'avis favorable d'un professionnel du chauffage ou des sapeurs-pompiers
Pour en savoir plus