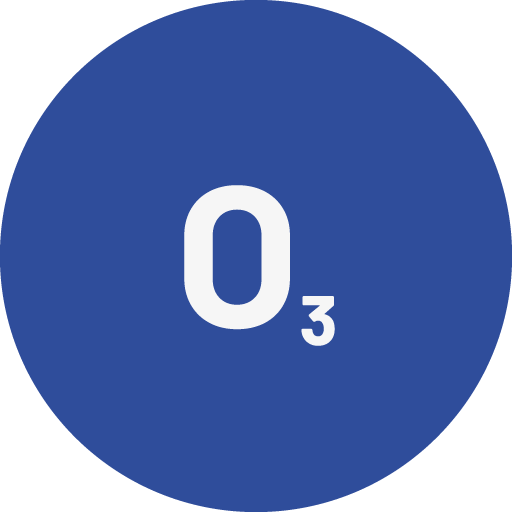Le changement climatique est aujourd’hui une réalité incontestable, dont les effets se font déjà ressentir à l’échelle mondiale. En France, l’augmentation des températures, la multiplication des épisodes extrêmes et l’évolution des régimes de précipitations transforment notre environnement et notre quotidien. Au-delà des impacts sur les écosystèmes et l’économie, ces bouleversements climatiques représentent un enjeu majeur pour la santé publique. Canicules, pollution de l’air, maladies infectieuses, troubles cardiovasculaires, santé mentale… le changement climatique est une menace multiple et grandissante pour la santé humaine, particulièrement pour les populations les plus vulnérables. Des études récentes mettent même en évidence un lien entre l’exposition à la chaleur et le vieillissement cellulaire. Face à ces constats, l’adaptation devient une nécessité pour limiter les effets du changement climatique sur notre santé et notre bien-être.
Qu’entend-t-on par « changement climatique » ?
Selon le Groupe d’experts intergouvernemental sur l’évolution du climat (GIEC), le changement climatique désigne une modification durable du climat, caractérisée par des variations de la moyenne et/ou de la variabilité de ses propriétés sur plusieurs décennies ou plus. Ce phénomène est principalement causé par les émissions de gaz à effet de serre issues des activités humaines : la combustion des énergies fossiles, la déforestation et l’industrialisation ont considérablement augmenté leur concentration dans l’atmosphère, perturbant ainsi l’équilibre climatique. Incapable d’absorber ces excès dans le cycle du carbone, la planète voit ces gaz s’accumuler, entraînant un réchauffement global.
Depuis la fin de la période préindustrielle (vers 1850), la température terrestre a connu une hausse rapide et marquée. Ce réchauffement se traduit par des vagues de chaleur plus fréquentes, des sécheresses accrues, une intensification des précipitations entraînant inondations et érosion, ainsi qu’un risque accru de submersion des zones côtières. Tous les territoires et écosystèmes sont affectés, impactant directement les populations et les activités humaines. Les conséquences du changement climatique ne se limitent pas à l’environnement : elles ont aussi des répercussions majeures sur la santé.
Ce phénomène est aujourd’hui scientifiquement démontré et observé. En France comme ailleurs, ses effets sont déjà perceptibles : vagues de chaleur plus intenses, sécheresses prolongées, cyclones, ouragans et incendies dévastateurs. Le dernier rapport du GIEC, publié en 2023, confirme que les émissions de gaz à effet de serre d’origine humaine sont responsables du réchauffement planétaire. Ce réchauffement a par ailleurs en 2024 clairement dépassé de 1,5 °C le niveau préindustriel – un seuil qui avait été fixé en 2015 par l’Accord de Paris pour réduire considérablement les risques et les impacts du changement climatique (selon le rapport mondial sur le climat de Copernicus publié en janvier 2025).
Le changement climatique est un phénomène global
Le réchauffement climatique ne signifie pas une hausse uniforme des températures partout sur la planète. Certaines régions se réchauffent plus vite que d’autres, notamment les pôles, où la fonte des glaces s’accélère. Par ailleurs, ce bouleversement climatique entraîne des modifications des courants océaniques et atmosphériques, pouvant provoquer des vagues de froid inhabituelles dans certaines zones. Ainsi, malgré des épisodes de froid localisés, la tendance globale reste une élévation des températures moyennes à l’échelle mondiale.
La situation en France
En France, la température moyenne a déjà augmenté de 1,7 °C depuis 1900, soit plus que la moyenne mondiale. La dernière décennie montre un réchauffement de 1,9 °C dans l’Hexagone, contre 1,15 °C à l’échelle globale. Cette hausse s’accompagne d’une augmentation des phénomènes climatiques extrêmes : vagues de chaleur plus fréquentes et intenses, sécheresses prolongées, tempêtes violentes et inondations destructrices. Ces bouleversements affectent l’environnement, l’agriculture, les ressources en eau et la qualité de l’air, posant de sérieux défis pour la santé publique.
Le réchauffement à +2 °C est désormais pratiquement inévitable, et une trajectoire à +4 °C d’ici la fin du siècle est envisagée si les émissions de gaz à effet de serre restent élevées. Selon les projections du Haut Conseil pour le Climat (HCC), un enfant né en 2020 pourrait vivre dans un monde réchauffé de +5 °C en 2090 dans le pire des scénarios. Des efforts majeurs sont nécessaires pour limiter ces impacts et s’adapter aux changements en cours.
Des conséquences multiples sur la santé
Le changement climatique affecte la santé humaine de manière variée et souvent interconnectée :
- Chaleurs extrêmes : elles aggravent la mortalité, notamment chez les personnes vulnérables (personnes âgées, enfants, populations défavorisées). Le nombre de décès chez les plus de 65 ans liés aux fortes chaleurs a bondi de 85 % entre 1991-2000 et 2013-2022 (The Lancet). En Europe, une étude récente (Gallo et al., Nature Medicine, 2024) comptabilise 47 312 décès attribués à la chaleur entre juin et septembre 2023. Si le réchauffement atteint 3°C, les décès annuels dus à la chaleur pourraient tripler d’ici 2100 (Lancet Public Health, 2024).
- Pollution de l’air : amplifiée par le réchauffement, elle favorise les maladies respiratoires (asthme, bronchites chroniques), les affections cardiovasculaires et certains cancers. Selon l’OMS, 99 % de la population mondiale respire un air dépassant les limites sanitaires. Un rapport de la Société européenne de pneumologie souligne que les patients souffrant de pathologies respiratoires sont particulièrement vulnérables, notamment les jeunes enfants dont les poumons sont en développement.
- Propagation de maladies : le changement climatique modifie les habitats des vecteurs de maladies (moustiques, oiseaux, rongeurs), augmentant la transmission de pathogènes. La dengue pourrait ainsi voir sa transmission bondir de 36 % avec un réchauffement de 2°C (The Lancet). D'autres maladies comme le chikungunya, la maladie de Lyme ou encore le choléra se propagent plus facilement en raison de l'évolution des températures et des précipitations.
- Santé mentale : les événements climatiques extrêmes causent des blessures, des traumatismes et augmentent le stress post-traumatique, l’écoanxiété (notamment chez les jeunes), la hausse des troubles psychologiques, tout en accentuant la précarité de certaines populations.
- Malnutrition et déshydratation : amplifiées par les sécheresses et la raréfaction des ressources alimentaires et en eau potable.
Le changement climatique impose donc un fardeau croissant sur la santé publique, nécessitant des mesures d’adaptation urgentes pour protéger les populations les plus vulnérables.
Un lien récemment démontré entre chaleur et vieillissement cellulaire
Des études récentes révèlent un lien entre l’exposition à des températures élevées et l’accélération du vieillissement cellulaire. Une étude menée par l’USC Leonard Davis School of Gerontology, publiée dans la revue Science, a suivi plus de 3 600 Américains de 56 ans et plus, originaires de différentes régions des États-Unis, avec des climats variés, pendant six ans. Les résultats ont mis en évidence un impact direct de la chaleur extrême sur l’horloge biologique. L’analyse de la méthylation de l’ADN – un marqueur clé du vieillissement cellulaire – montre que les personnes vivant dans des régions plus chaudes présentent un âge biologique supérieur pouvant aller jusqu’à 14 mois de plus par rapport à celles vivant dans des zones plus tempérées. L’effet est d’autant plus marqué pour les individus exposés de manière prolongée aux températures élevées.
Cette accélération du vieillissement biologique réduit la capacité des cellules à se régénérer et augmente le risque de maladies liées à l’âge, comme les pathologies cardiovasculaires et neurodégénératives. De plus, l’étude souligne que quelques jours seulement d’exposition à la chaleur suffisent à provoquer un vieillissement accéléré, bien que l’effet soit amplifié par des vagues de chaleur répétées. Ces résultats renforcent l’urgence de protéger les populations vulnérables face à l’augmentation des épisodes de chaleur extrême induits par le changement climatique.
De la nécessité de s’adapter
Face à ces enjeux, l’adaptation devient une priorité. Il est essentiel d’aménager les villes pour limiter les îlots de chaleur, de renforcer l’isolation des bâtiments, de développer des espaces verts et de repenser l’organisation du travail en période de canicule. La surveillance des maladies émergentes, l’amélioration de la qualité de l’air et l’éducation aux risques climatiques doivent également être renforcées. Enfin, une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre reste la meilleure solution pour limiter les impacts sanitaires du changement climatique à long terme.
À l’échelle nationale, la France s’est engagée dans cette dynamique avec le troisième Plan National d’Adaptation au Changement Climatique (PNACC), qui prévoit plus de 200 mesures concrètes pour anticiper et limiter les impacts du réchauffement sur les territoires, les infrastructures et la biodiversité. Ce plan insiste sur la nécessité d’un financement accru et d’une approche systémique, intégrant tous les secteurs et toutes les zones particulièrement exposées (littoraux, montagnes, forêts, agriculture).
Toutefois, l’adaptation ne peut pas se suffire à elle-même : seule une réduction drastique des émissions de gaz à effet de serre permettra de limiter l’ampleur du dérèglement climatique et de limiter ses effets délétères sur la santé et les écosystèmes. Comme le rappelle le GIEC, le déni n’est plus possible : il faut accélérer les actions de prévention et de transformation pour préserver le bien-être humain et la santé de la planète.
La TRAAC, un outil au service des politiques publiques en BFC
Dans le contexte d’un réchauffement global affectant l’ensemble des territoires, la définition d’une trajectoire climatique de référence constitue un enjeu fondamental pour anticiper les transformations à venir et pour s'adapter. La TRAAC (Trajectoire de Réchauffement de Référence pour l’Adaptation au Changement Climatique) a été élaborée afin de fournir une base scientifique robuste permettant de quantifier les impacts du changement climatique à une échelle fine.
La mise en place de la TRAAC permet notamment de définir des scénarios de référence, renforcer les politiques d’adaptation, anticiper les risques climatiques, intégrer les données climatiques aux référentiels techniques, accompagner les collectivités et les secteurs économiques.
Vous pouvez visualiser les données de la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique sur la plateforme OPTEER dans la fiche dédiée.
Les bons gestes
Pour parvenir à réduire les émissions de gaz à effet de serre et à s'adapter, il faut modifier nos modes de vie, mettre en œuvre des politiques nouvelles, réinventer des pratiques adaptées.
Parmi les gestes à notre portée :
Déplacements
- Quand c’est possible, je favorise les modes de déplacement doux (vélo, trottinette, marche…)
- Je privilégie les transports collectifs ou partagés
- En vacances, j’opte pour le train plutôt que l’avion
- Quand c’est possible, je limite l’impact de mes trajets domicile-travail en pratiquant le télétravail
Alimentation
- Je préfère les produits de saison et locaux
- Je diminue ma consommation de viande et de produits laitiers
- J’évite les produits transformés et préfère cuisiner moi-même
- Je bois de l’eau du robinet plutôt qu’en bouteille
Demande énergétique
- Mon logement est isolé
- J’utilise des ampoules basse consommation
- J’éteins mes appareils en veille
- Je débranche mon chargeur lorsque je ne l’utilise pas
- Je me chauffe raisonnablement : 19°C dans les pièces à vivre, 17°C dans les chambres… quitte à enfiler un pull !
- Je purge mes radiateurs à eau en début de saison de chauffe
- Lors de l’achat d’un équipement, je me fie à l’étiquette énergie pour m’orienter vers les plus performants
- Mon chauffe-eau est réglé à une température de 55 °C à 60℃
Biens de consommation et services
- Je n’achète que le nécessaire
- Je choisis des équipements de seconde main
- Je fais réparer le plus possible
- Je m’oriente vers des solutions de location ou de partage quand elles existent
- Je favorise les circuits courts
- Je privilégie le réutilisable plutôt que le jetable
- Je limite et trie mes déchets
- Je favorise les matériaux recyclés
En savoir plus